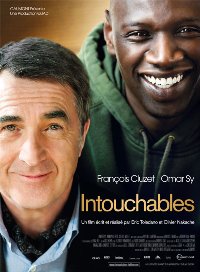de Robert Guédiguian
France, 1h47, 2011.
Festival de Cannes 2011, sélection Un Certain Regard
Sortie en France le 16 novembre 2011.
avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Grégoire Leprince-Ringuet, Marilyne Canto.
Retrouvant Marseille et la forme du conte, Robert Guédiguian met à l’honneur la solidarité sans faille et la dignité de « la France d’en-bas » plongée dans la tourmente économique.
Fidèle à sa famille d’acteurs depuis ses premiers films – Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan – Robert Guédiguian revient à Marseille 15 ans après Marius et Jeannette. Les personnages, héros ordinaires de vies simples, ont vieilli et sont maintenant dans la génération des jeunes grands-parents, heureux de cette nouvelle génération. Sur le plan social, la situation s’est aggravée, les pré-retraites ne sont pas un choix et le chômage est toujours un risque réel. Mais une nouvelle fracture est apparue, qui monte « les pauvres gens » les uns contre les autres.
L’expression « les pauvres gens » est tirée d’un poème de Victor Hugo et, Robert Guédiguian a conscience de l’importance de cette appellation : « Pour moi, l’une des choses les plus graves dans la société actuelle, est qu’il n’y ait plus de conscience de classe. Au sens où on ne peut même plus dire « classe ouvrière », c’est pourquoi je dis les « pauvres gens ». Or la conscience d’être des « pauvres gens » n’existe pas. Il s’avère qu’il n’y a plus, en France, les grandes unités industrielles qui existaient encore dans les années 1970-80, où trois mille ouvriers sortaient de l’usine. La conscience de classe, à ce moment-là , était non seulement possible, mais elle se voyait : elle était matérialisée par ces milliers d’hommes en bleu de travail. Et, tout naturellement, les gens étaient ensemble, ils avaient des intérêts communs, y compris, d’ailleurs, quand ils avaient des identités différentes. Il n’y a pas deux peuples, l’un autochtone, salarié, syndiqué, pavillonnaire et l’autre chômeur, immigré, délinquant, banlieusard. La politique et le cinéma peuvent œuvrer à démasquer cette imposture intellectuelle. Je ne changerai jamais d’avis là -dessus : c’est là l’essentiel ».
Les personnages principaux des Neiges du Kilimandjaro sont donc des gens qui ont travaillé toute leur vie dans les docks, qui se sont battus pour le respect des droits sociaux et pour qui la fraternité se vit au quotidien. Face à eux, des jeunes en détresse ne connaissant rien de la vie syndicale ou du débat politique, qui veulent juste prendre leur part du gâteau. Et tous les moyens sont bons puisqu’ils sont au-delà de toute conscience de classe, de toute idée de soilidarité. La rencontre est explosive et l’incompréhension amère.
Comme à son habitude, le réalisateur n’utilise aucun artifice pour poser l’histoire et les protagonistes. Tout se déroule dans une grande simplicité, où l’émotion peut naître sans recours au spectaculaire, où le récit linéaire se met à portée du spectateur sans le sidérer. Tous les personnages, même les seconds rôles, ont la possibilité de donner leur point de vue, ce qui rend la situation plus complexe que la forme du film pourrait le faire croire. On pense notamment à « la mère indigne », défendue avec colère dans une scène poignante que l’actrice Karole Rocher porte avec beaucoup d’intelligence et de passion.
Les Neiges du Kilimandjaro, que nous ne verront pas comme ce couple à qui elles étaient offertes en cadeau, est un beau portrait de la « France d’en-bas ». Généreuse, solaire et fraternelle, où les héros et les exploits sont ceux dont on ne parle jamais mais qui permettent à toute une société d’avancer.
Jean Jaurès, Discours à la jeunesse, Albi, 1903.
() « Le courage, c’est d’être tout ensemble, et quel que soit le métier, un praticien et un philosophe. Le courage, c’est de comprendre sa propre vie, de la préciser, de l’approfondir, de l’établir et de la coordonner cependant à la vie générale. Le courage, c’est de surveiller exactement sa machine à filer ou à tisser, pour qu’aucun fil ne se casse, et de préparer cependant un ordre social plus vaste et plus fraternel où la machine sera la servante commune des travailleurs libérés. ()
Le courage, c’est de dominer ses propres fautes, d’en souffrir mais de n’en pas être accablé et de continuer son chemin. Le courage, c’est d’aimer la vie et de regarder la mort d’un regard tranquille ; c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel ; c’est d’agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l’univers profond, ni s’il lui réserve une récompense. Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire ; c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques ». (…)