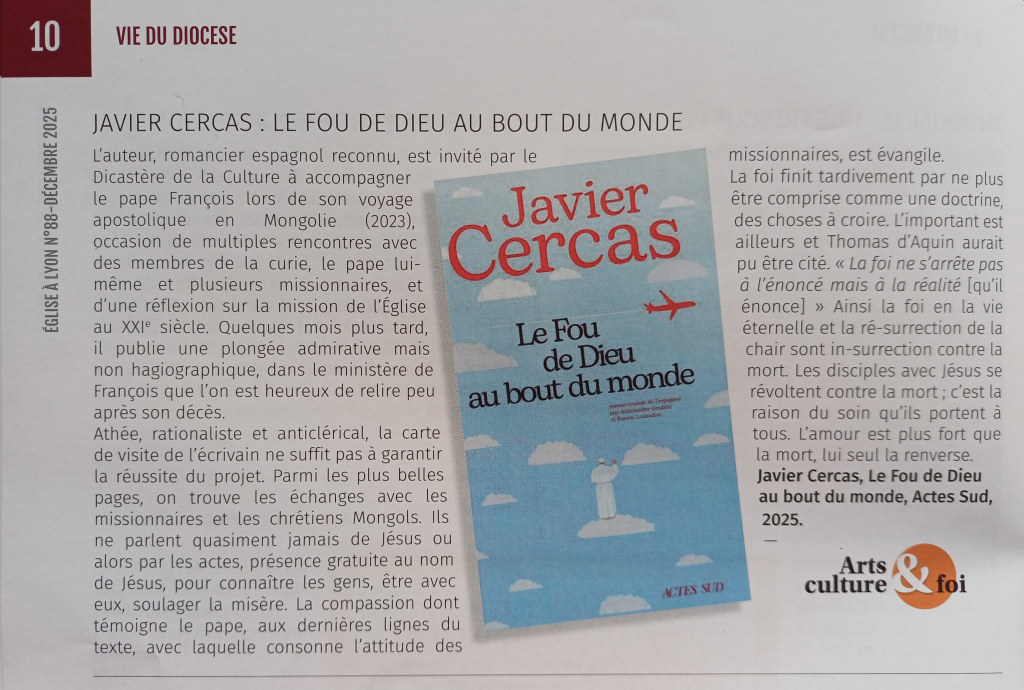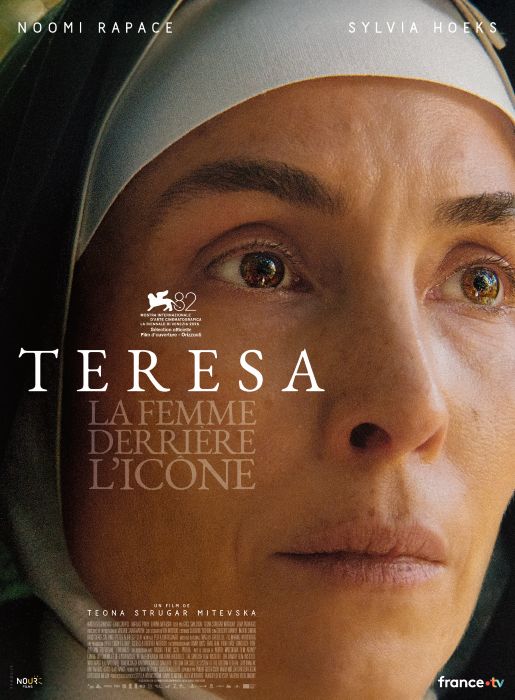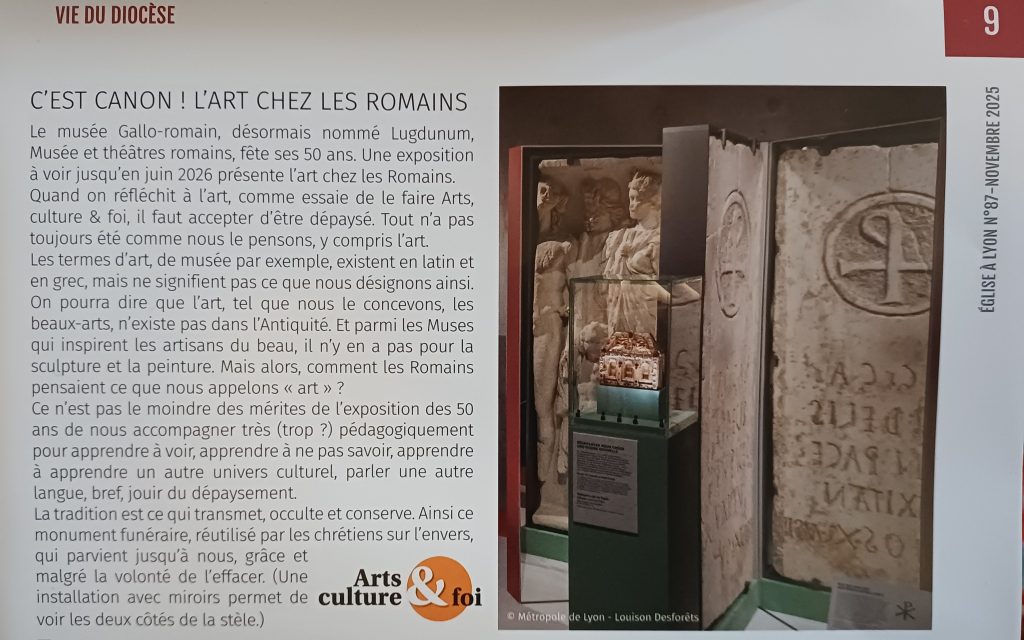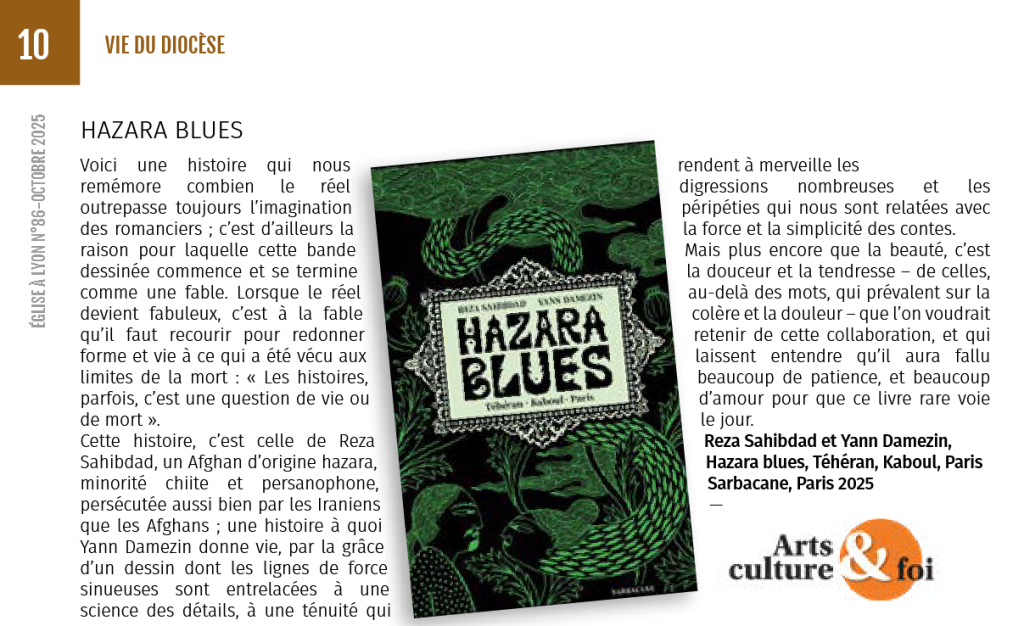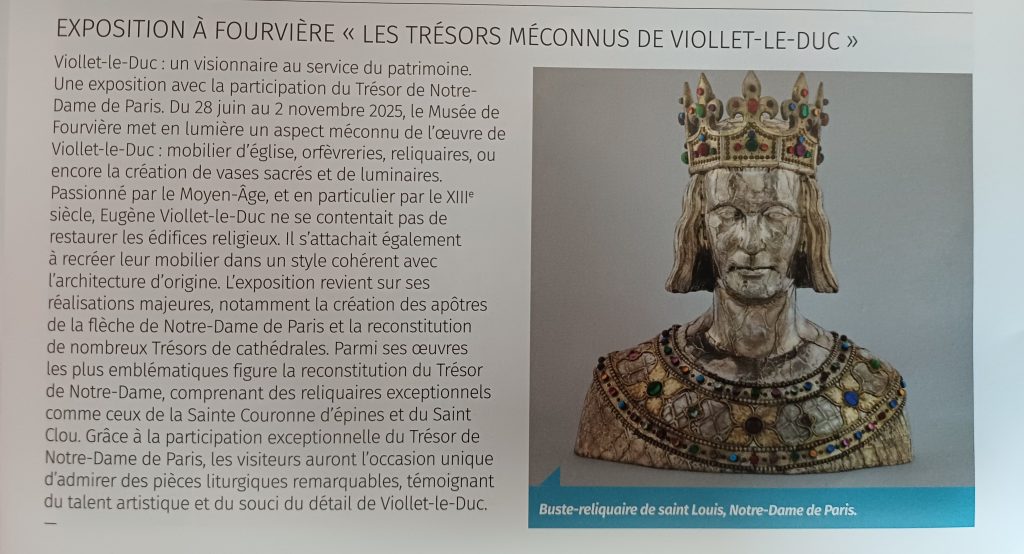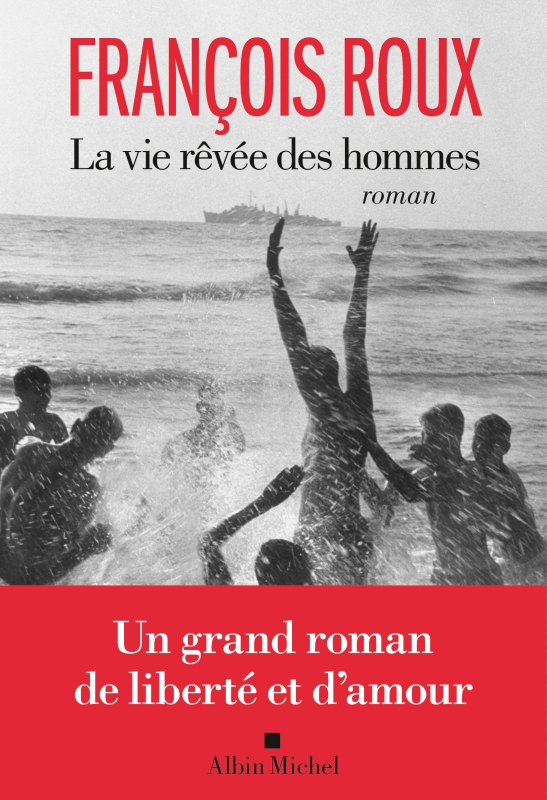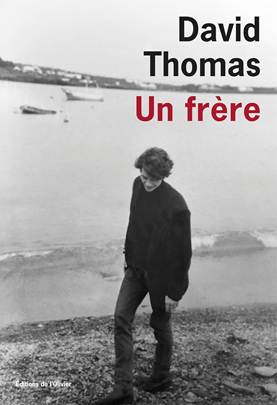
Thomas David, Un frère, édition de l’Olivier, Paris 2025
Le récit de la maladie mentale fait entrer dans le monde parallèle et inhospitalier de ladite maladie, une prison, relégué. Pourquoi faudrait-il l’habiter ? Parce que l’on est soi-même malade et que l’on n’y échappe, parce que l’on est soignant, parce que l’on est parent, frère, sœur, conjoint, ami.
Comment parler de son frère que la maladie rend hostile et qui demeure celui que l’on aime, qu’il faut parfois protéger contre lui-même, que l’on ne sait plus fréquenter par ce que sa maladie détruit son entourage en le détruisant ? La maladie est incurable, handicap de santé et handicap social, inéluctable, jusqu’à la mort.
C’est la beauté de ce court texte, composé de courts fragments, dire l’affection plus fort que l’horreur, l’impuissance bienveillante plus forte que la violence destructrice. La vie se dit en éclats, la colère d’une lave qu’arrête seulement la fin de l’éruption, éclair éblouissant de tendresse et de finesse, obsessions que les nombreuses anaphores donnent à voir un peu…
Le malade a voulu être debout et renverser le Titan ; ses parents dans leur souffrance et abattement ont voulu rester debout, pour ne pas sombrer et ralentir la chute de leur enfant. Ecrire est une manière de se tenir debout. Le combat est perdu d’avance. La souffrance est là, la mort arrive, la sienne, la nôtre. Opposer le redressement à ce qui avilit, même vain en définitive, c’est cela vivre. Devant la violence de ce qu’est vivre, certains projettent le repos et la vraie vie après la mort. Les disciples du chemin, de la vérité et de la vie ne sont-ils pas ceux qui œuvrent au relèvement ici et maintenant, qui veulent eux et les autres debout, même grabataires ?
Le récit est ainsi tout sauf une chronique de l’ensevelissement, lutte contre le recouvrement. Ce qui le rend urgent et nécessaire, c’est de recouvrer la vie qui fait encore vivre, même après la mort. L’écriture ne soigne pas de la perte ou de quoi que ce soit. On ne fait pas le deuil des gens que l’on ne supporte pas de ne plus pouvoir serrer dans ses bras : ils ont emporté dans le tombeau ce que nous étions avec eux. Ecrire, c’est faire sortir du tombeau ce que nous sommes encore avec eux. Ecrire, c’est aussi vain que se tenir debout, mais c’est vivre. Il y a de l’illusion à donner du sens là où il n’y en a pas. Affirmer qu’il n’y a pas de sens est déjà une manière de mettre de l’ordre, du discours, du sens. Le sens est une stratégie pour avoir prise sur le réel parce qu’il faut bien tenir.