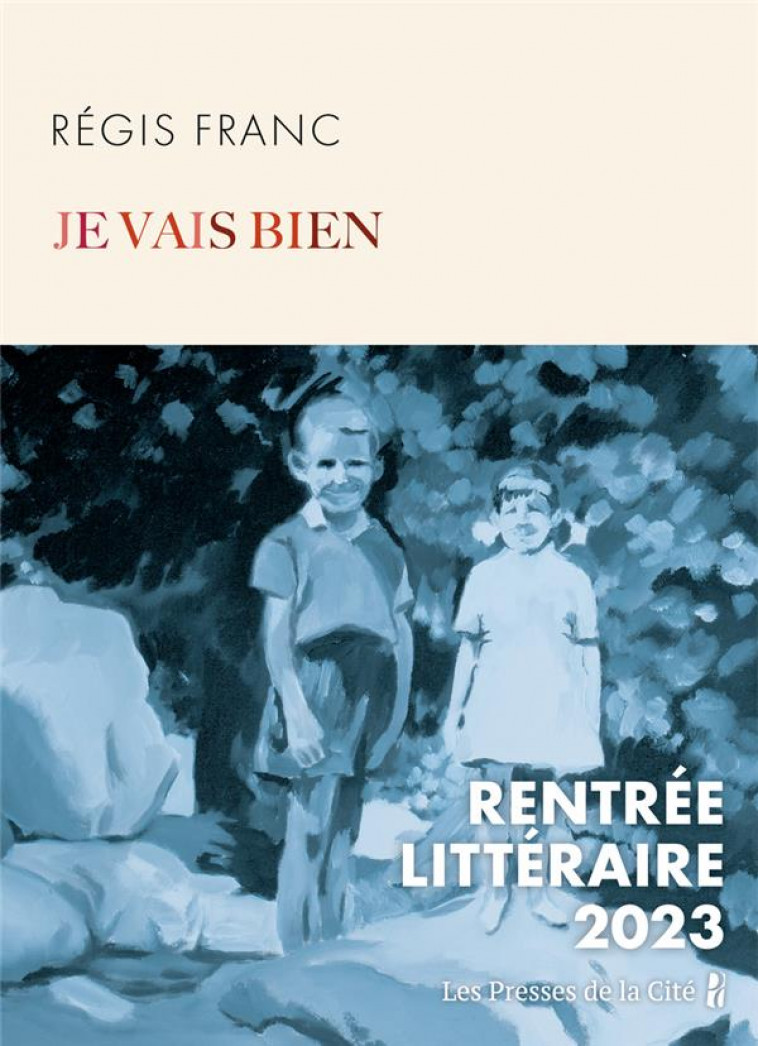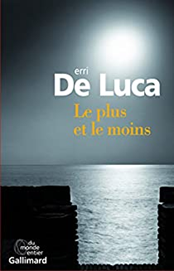Gilles Baudry et Philippe Kohn, Haute lumière, Locus solus, Châteaulin 2018
La poésie, parfois, ce sont quelques mots sur une page. Beaucoup de blanc, ou de marge, le vide qu’une centaine de caractères, ou à peine davantage, rend visible. La périphérie est un lieu hospitalier d’où l’on voit ce que l’activité trépidante du centre, place to bee, ne laisse pas soupçonner.
La poésie de Gilles Baudry est de celle-là. Un silence d’abord, puis, évanescente, une voix de fin silence. A son tour, le lecteur devra certes faire silence, écouter. Cela ne suffira pas, parce que, comme dit le psaume, un autre poème, « pas de voix dans ce récit, pas de mot qui s’entende ».
L’ouvrage est une forme de commentaire de la Règle de Benoît sous laquelle le poète s’est placé depuis bien longtemps déjà. Ou plutôt, une stratégie pour faire entendre le silence à partir de la règle et de la pratique bénédictine de la vie. Chaque page tournée, plus encore que dans d’autres de ses recueils, touche l’insaisissable. C’est une caresse, une brise de paix, tout autant que l’air du large à respirer à pleins poumons, la force renversante de l’inouï.
Les photos de petits riens de Philippe Kohn montrent ce que les yeux ne voient pas et les mots de Gilles Baudry, fragiles, ourlent la vie de tout ce que l’on n’entend pas. Pas une ligne n’est de trop, n’est maladroite ; prodige de justesse à couper le souffle. On voudrait tout citer, mais ce serait passer à côté, rater l’é-vocation, appel parfois ironique où se lit qui nous sommes, au bord du silence. Les textes ou les photos marquent comme des balises pour une traversée que renouvelle chaque lecteur ; c’est à une expérience qu’il est conduit, au bord du silence.
Peut-être une réserve, quant au titre : est-il le meilleur ? Pour le disciple, il n’y a plus de hauteur depuis que la terre a vocation d’être ciel.
| On viendrait, paraît-il, de loin pour écouter les moines se taire mais le silence est moins ce qui se tait que ce qui nous éclaire. Ici, tout exhale la solitude ouverte et la porosité de la clôture. En marge mais au cœur du monde en filigrane de la page. Non l’inhumain isolement mais la juste distance, le retirement l’inassimilable solitude élue, l’autre nom de l’amour. | Une parole sans parole est la patrie. C’est elle qui modèle et module nos vies. C’est elle qui nous porte et nous emporte loin de nous. |
| Riches de ce qui nous manque, la grâce enfin serait d’être touchés à l’invisible de ce que nous sommes. |




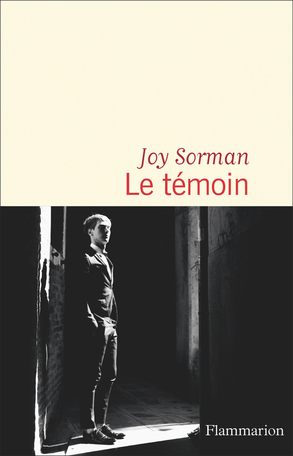

:quality(50)/2023/09/08/amoudi-mokhtar-couv-avec-bandeau-les-conditions-ideales-64fb0813eeb3c471743287.jpg)