
passages d’un monde à l’autre, il ouvre à l’humain.
Chair des mots. Est-ce un oxymore. Le flatus vocis, le souffle de la voix est chair, c’est-à-dire aussi érotisme. Il n’y a pas ce chair sans désir, ou plutôt, les mots transforment la chair en désir.
Comme un écho, que le texte de Atiq Rahimi ignore : Kai o logos sarx egeneto, Et le mot est devenu chair.
Une poétesse persane dont la biographie est incertaine, au XIIe siècle, laisse quelques quatrains, que l’auteur lit, présente, met en intrigue dans un dialogue avec elle, Mehstî. Il passe par-dessus les siècles comme par-dessus les obstacles, l’impossibilité de la traduction. Ce n’est pas sans risque, y compris de récupération idéologique. Mais sans les passeurs de mots, sans les dialogues par-delà les âges et les cultures, c’est tout ce dont notre mémoire serait ignorante dont nous ne pourrions nous nourrir, réduits à un passé fait seulement d’un attachement infantile et affectif à notre mère. Les intégrismes ne savent rien de l’histoire et canonise comme passé ce qu’ils imaginent être la religion de toujours, celles de leurs pères les plus immédiats.
La poétesse qui parle et chante si crûment ne peut qu’apparaître comme une résistante à la phallocratie. La parole, la poésie est politique ; la chair, celle de la femme, ses cheveux qu’il faudrait dissimuler est politique. Aujourd’hui, en Iran, après le meurtre de Masha Amini, elles crient et chantent et espèrent à moins d’être tuées : Femme, Vie, Liberté ! « En détachant ton corps et ta poésie de toute métaphore, tu ne t’attaches qu’aux mots nus de la vérité. Mais cela ne t’empêche pas de jouer avec les expressions ambivalentes. »
« Un soufi, dans le silence de sa méditation, eut soudain la vision d’une femme se livrant aux jeux de l’amour dans une maison de passe. / Seigneur, soupire le soufi, de grâce, donne-moi cette femme ! / Non, fit la Voix, pourquoi n’as-tu pas prié que je te donne, toi, à elle ? »
Le sexe est subversif. Même le plus rigoureux des ascètes n’y peut rien. Pas étonnant que les religions s’en méfient. Ce n’est pas une question de genres, tous sont renversés ; les hommes ont besoin des femmes, c’est leur force jusqu’à la subversion ; (Le sultan aime son bel échanson ; c’est aussi la force subversive de l’homosexualité.) Le sexe et le désir, les mots de la poésie, hier et aujourd’hui, sont politiques. On comprend que l’homme oublie si vite qui s’endort pour ne pas rester pris dans les rets de l’amour, de la dépendance. Cachez ces cheveux que je ne saurais voir : refus de la confrontation au secret que nous sommes.
Les religions se méfient du sexe, les mots crus, nus. C’est qu’il est, comme l’ivresse du vin, une dénonciation de l’hypocrisie. Un cheikh dit à une débauchée : « Tu es ivre / Et à chaque instant tu te donnes à quelqu’un » / Elle lui répond : « Je suis ce que tu dis, certes / Mais toi, es-tu ce que tu parais »
Subversif ou salut de la foi, contrairement à ce que l’on pourrait penser. L’amour, l’aimance, y compris légère, y compris adultère ou prostituée, l’aimance comme religion, non pour faire de la vibration des corps un dieu, mais parce que Dieu serait amour. Ce n’est pas dit pas Atiq Rahimi. C’est une autre histoire, pas si différente cependant de celle de Mehstî, celle du Cantique des Cantiques.


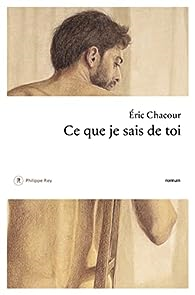

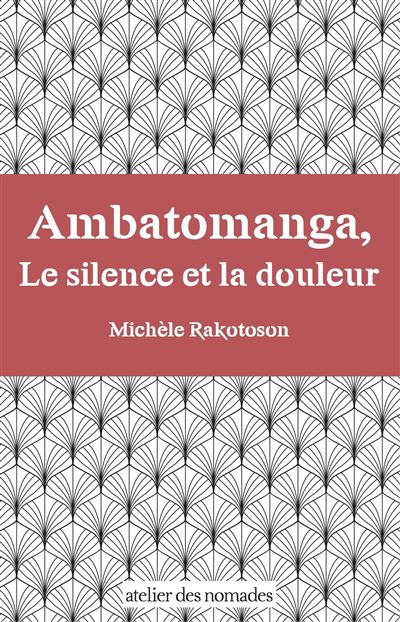 Atelier des nomades, 2022
Atelier des nomades, 2022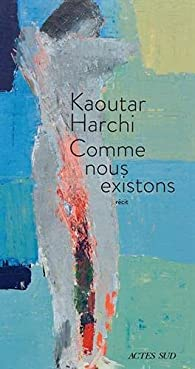 Actes Sud, Arles 2021
Actes Sud, Arles 2021
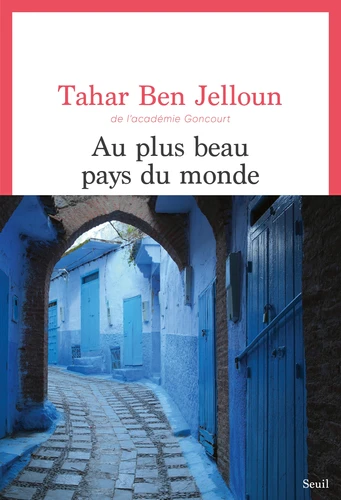
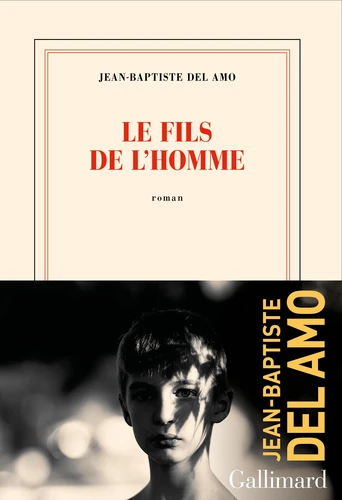
/image%2F1338740%2F20230210%2Fob_bd77a6_bolla.jpg)


