
Brandon TAYLOR, Real life
Théo BOURGERON, Ludwig dans le living
Sarah JOLLIEN-FARDEL, Sa préférée
Gaëlle JOSSE, La nuit des pères
Une rapide présentation de quatre beaux textes

Brandon TAYLOR, Real Life, La croisée, Paris 2022
Depuis plusieurs années, on dénonce ici où là le wokisme qui, selon ses détracteurs, serait une idéologie fondée sur des travaux de sciences humaines, études de genre ou féministes, déconstruction du grand récit historique, celui du moins qui s’écrit du point de vue des vainqueurs.
Point de théorie sociale ici, mais quelques mois de la vie d’un doctorant en biologie avec le groupe d’étudiants auquel il pourrait appartenir. Transfuge de classe, noir et gay, cela fait beaucoup pour parler juste de ses sentiments, pour savoir que penser de ce que l’on expérimente du monde et des relations avec les collègues.
Comment se fait-on des amis ? Comment entre-t-on dans un groupe amical ou professionnel ? Que dit-on ? Pourquoi ? Que ne dit-on pas, ne serait-ce que parce que l’on ne sait pas le dire ? En quoi l’histoire personnelle conditionne la manière de rencontrer et vivre avec les autres ? Chaque parole semble si peu disposée à exprimer ce que l’on veut dire, risque si souvent d’être mal prise, qu’il est tentant de se taire. Mais le silence n’est-il pas un refus d’entrer en relation ? La mise en intrigue de ces questions à travers la singularité du protagoniste renvoie chacun à ce à quoi il est sans cesse confronté, exister avec les autres, grâce à eux, malgré eux. Jamais on n’existe sans les autres… pour le meilleur ou pour le pire.

Théo BOURGERON, Ludwig dans le living, Gallimard, Paris 2022
Une histoire aux frontières du polar, de l’anticipation et de l’absurde, le roman de Théo Bourgeron décrit notre monde.
Comment ne pas voir l’évidence ? Le monde s’efface, comme s’il était bouffé par pans entiers. Il laisse des trous que personne ne semble voir, qui n’étonne pas. Même l’anti-héros qu’est le personnage principal ne se rend pas compte de l’étrange par exemple d’un RER qui n’arrive jamais. Mais qui cela étonne-t-il en 2022 ? Alors en 2032, pensez donc ! La catastrophe n’est pas nommée, mais l’on peut penser à l’effondrement de la biodiversité, la fonte des glaces qui laissent des trous béants. Mais la vie continue comme si rien n’était.
Qui est cet ogre ? Ludwig Wittgenstein. On pourra se demander pourquoi lui plutôt qu’un autre. L’auteur ne le dit pas. Dans une interview, il avance que Wittgenstein lui est comme refilé par le réemploi romanesque qu’en fait Thomas Bernhard. Il me semble qu’il y a tout de même plus, une question au cœur de la réflexion du philosophe, l’évidence, la tautologie et la logique. Et personne ne voit rien. Ce n’est pas seulement l’indifférence face à la catastrophe, mais l’interdiction de voir le problème. Les lanceurs d’alerte passent pour des fous, sont inquiétés par la police, parfois incarcérés. Sans doute aussi, le côté abscons du texte wittgensteinien rend logique, si l’on peut dire, que personne ne comprenne rien à ce qui se passe.
N’est-ce pas ce que beaucoup pensent, ou ont longtemps pensé : il absurde de dire que le climat change, aussi incongru que le retour de Wittgenstein quatre-vingts après sa mort, buvant des quantités de litres de lait. Parallèlement au changement climatique, c’est aussi le bouleversement des conditions sociales dont parle le roman. Le protagoniste est chercheur en philosophie mais ne vit que grâce à son emploi de responsable de rayon dans un supermarché de ville. Un post-doc ne trouve pas de boulot et après des années de courses à ce qui est rentable, c’est normal qu’il occupe le bas de l’échelle sociale. L’exploitation de la nature au point de la détruire est la même que celle des salariés, quel que soit leur niveau d’étude.
Avec les exploitations, il est d’autres choses qui nous bouffent, d’autres ogres, comme le discours savant de la recherche et tout ce qui est susceptible de nous obnubiler, obséder. Personne n’échappe au néant qui le happe, à moins peut-être de se livrer à l’autre, ce dont le protagoniste ne semble pas avoir la moindre intuition quoi qu’il en soit des stimuli sexuels.
J’exagère beaucoup à réduire le texte à une thèse. C’est trop peu. Le roman nous promène, nous emmène, et l’on pourrait ne pas même se rendre compte que derrière l’absurde se joue ce que nous vivons.

Sarah JOLLIEN-FARDEL, Sa préférée, Sabine Wespieser, Paris 2022
La violence engendre la violence. Même quand on veut s’y opposer, impossible d’y échapper. Seule la bonté guérit de la violence. Et quand on ne parvient pas à se laisser atteindre suffisamment profondément par l’amour, reste à se retirer pour protéger les autres et soi-même. Car le violent souffre de sa propre violence, incapable qu’il est de la maîtriser, d’être lui.
Sa préférée, premier roman de Sarah Jollien-Fardel, raconte l’histoire de Jeanne, dont le père terrorise la famille. Il ne sait retenir la haine qui l’habite et exerce une méchanceté cruelle, comme lorsqu’il oblige de force sa fille à assister à la noyade de son chat. Cet animal est sa joie, son réconfort. Elle hurle à en perdre non pas la voix mais la parole pendant des jours.
Cette même fille « sa préférée », terriblement prénommée Emma, il la viole. Son épouse, il la frappe, l’insulte, l’écrase. La cadette, Jeanne ne survit qu’à fuir et se reproche d’avoir lâchement abandonnée mère et sœur, découvre qu’elle est elle-même capable de violence et de méchanceté crasse. C’est une histoire de la violence, comme aurait dit E. Louis, non celle que l’on subit une fois, terrible, d’un inconnu, mais celle ordinaire, répétée, cachée, tabou de celui qui est censé vous protéger, vous élever, vous apprendre l’humanité.
Il y a aussi Marine et Paul. Ils sont les amants de Jeanne qui ne sait se laisser aimer. Ils parviennent, un peu, à la reconduire à une humanité sensible, à quitter la peau tannée, carapace qui protège, à quitter la carapace qu’est le caractère forgé pour se protéger plus que pour se défendre, pour survivre ou plutôt faire croire que l’on est vivant alors que Jeanne est mort-née, mort vivante.
Prix du roman Fnac et premier Goncourt des détenus, sa lecture a un effet cathartique, il provoque à interroger sa propre violence. Les cinq-cents détenus de trente-et-un établissements pénitentiaires auront sans doute reconnu ce qu’ils ont souffert ou fait souffrir, y compris lorsque l’alcool ne permet plus de voir le mal que l’on inflige. Parfois eux-mêmes parents, dont les enfants sont la raison de vivre, fantasmée ou non, ces mêmes enfants peuvent être leurs victimes ou pour le moins victimes collatérales de l’incarcération.
La violence intrafamiliale n’est pas toujours sanctionnée et il n’est pas sûr que l’incarcération sont la meilleure réponse à ces crimes et délits. L’autrice, lors de la remise de son prix s’exprimait ainsi : « On s’est rencontrés pour de vrai. […] Ce qui s’est passé entre vous et moi restera entre vous et moi, sachez que je ne l’oublierai jamais. Je reçois ce prix comme un immense cadeau. Tout m’a secouée. La littérature est une fenêtre ouverte sur le monde, une main tendue à l’autre. […] Sa préférée vous a rencontrés. Merci du fond du cœur. »
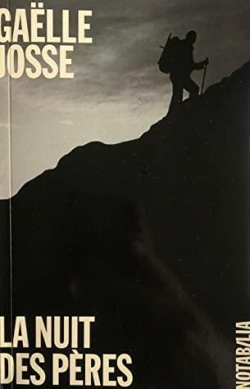
Gaëlle JOSSE, La nuit des pères, Les éditions Noir sur Blanc, Paris 2022
La violence des pères. Dans les prisons, il y a bien quelques mères infanticides ou maltraitantes. Mais on ne compte plus les pères. Les meurtres sur conjointes ne diminuent pas par exemple. Plusieurs de ces hommes condamnent la violence contre ceux de sa famille, mais sont pris dans la contradiction où les placent leurs actes.
Dans le roman de Gaëlle Josse, la violence n’est pas physique. C’est celle de l’ignorance et des cris, de la peur de chaque minute de déclencher un cataclysme parce qu’on aura été milieu du passage ou du regard du père. C’est la quasi impossibilité du père, refilée comme une maladie héréditaire, d’être seulement sensible ; la fuite s’impose qui fait un refuge de l’univers du travail. Et ça bousille des vies, celles des enfants, celle du conjoint, celle du père. L’autrice raconte l’histoire d’un père, mais intitule son texte Nuit des pères.
Il y a-t-il une possibilité de stopper la violence ? Y a-t-il une possibilité de mettre fin à ses conséquences ou au moins de les endiguer ? Dans quelle famille ne se posent ces questions, ou ne devraient-elles se poser ? On apprend la raison de la violence du père. Cela le rend plus humain. Est-ce assez pour comprendre pourquoi il n’a rien fait pour essayer de sortir de sa violence ? Est-ce assez pour pardonner ou se réconcilier ?


