
Autant qu’on puisse le savoir sans être spécialiste de l’affaire, le scenario de L’enlèvement n’est pas en tout point d’une exactitude historique irréprochable. Il s’empare de l’affaire Mortara, un enfant juif enlevé à sa famille sous-prétexte qu’il aurait été baptisé et devrait en conséquence être élevé dans la foi catholique. Nous sommes sous Pie IX, en 1858, et l’on perçoit combien une disposition du droit canonique qui jusqu’alors n’avait guère suscité de réactions devient incompréhensible et est comprise comme une violence insupportable, contraire à la morale et aux droits fondamentaux. L’Eglise de Pie IX, dans la seconde partie de son pontificat surtout, est celle d’une condamnation intransigeante de la modernité. Le monde de l’Eglise s’effondre comme un mur, quasi sans victimes, quasi sans résistance.
Le décalage entre la fiction et l’affaire invite à regarder une fable. Le réalisateur ne retrace pas un épisode historique, mais propose une réflexion sur la violence institutionnelle, celle qui prend la forme de la vérité comme dogme ou conviction indépassable. Cela n’empêche ni la bonté ni l’authenticité et la probité. L’inquisiteur ou le Pape paraissent décidément butés dans leur intransigeance, sûrs d’eux-mêmes, du droit, de leur vérité : non possumus. La question demeure cependant pour Mortara devenu prêtre ou pour sa mère, fidèle jusqu’à la mort à sa foi. Le seul que l’on voit changer de camp est le frère aîné. Mais est-il plus libre ou seulement une girouette orientée par le vent du moment ?
Dans l’établissement où l’enfant enlevé à ses parents est élevé, il ne manque pas d’attention. Le rapt réussit doublement, non seulement prise de corps mais possession idéologique. L’homme adulte n’est-il que la victime d’un lavage de cerveau, d’un formatage ? A-t-il un libre arbitre ? Chacun est la conséquence du contexte dans lequel il grandit. Ce déterminisme est-il plus ou moins plus acceptable que la violence des puissants ?
Demeure la question de la violence chrétienne. Comment les disciples d’un Juif ont-ils pu opprimer les Juifs ? Comment les disciples d’un juste condamné violemment peuvent-ils user de la violence et de la force ? Ils finissent pas n’être que les traitres à leur propre maître, mais ils ne peuvent le voir, refusent de le voir. Les clous qui attachent Jésus sur la croix sont bien peu par rapport à l’arraisonnement d’une vérité ininterrogée. Il faut rendre sa liberté à Jésus, comme une résurrection, le dépendre de la croix où l’Eglise le garde sous la main. On attend que Jésus soit libéré des liens idéologiques, comme décloué. Le film ne va pas plus loin. On peut s’interroger : L’Eglise peut-elle agir autrement qu’en propriétaire exclusive de son Seigneur ? Que serait-elle alors ? Qu’apporterait-elle au monde ?
Le scénario est moins unilatéralement anti-ecclésial qu’il n’y paraît, davantage une sorte de psychanalyse qui invite à fréquenter ce qui nous façonne, pourquoi nous tenons à nos convictions parfois plus fort qu’aux liens du sang, jusqu’à la mort. Plusieurs mises en parallèles, entremêlements de scènes qui se jouent dans des espaces différents accentuent la relativité des dites convictions, déterminations, identités, positionnements identitaires. La prière juive est mont(r)ée source et sœur de celle des chrétiens, le jugement du tribunal comme une folie.
La subtilité du propos est aussi profonde que la beauté des images. La musique de Chostakovitch annonce une Eglise et un monde pris par la folie. Politiques ou religieux, nos conditionnements nous donnent-ils la possibilité d’être lucides, libres… et bons ?


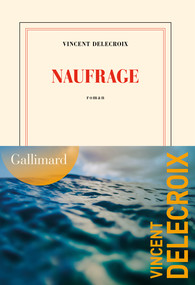
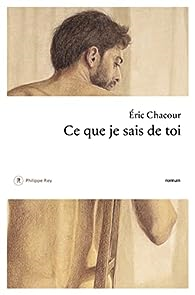


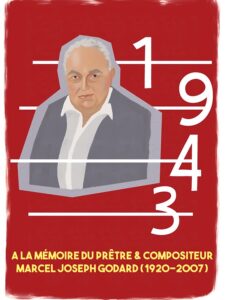
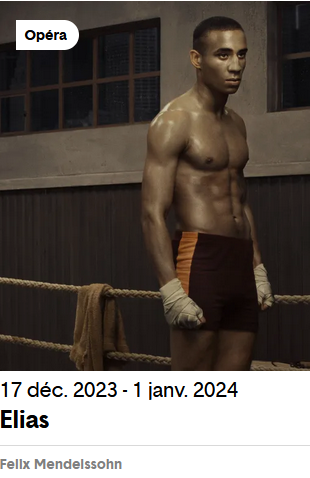
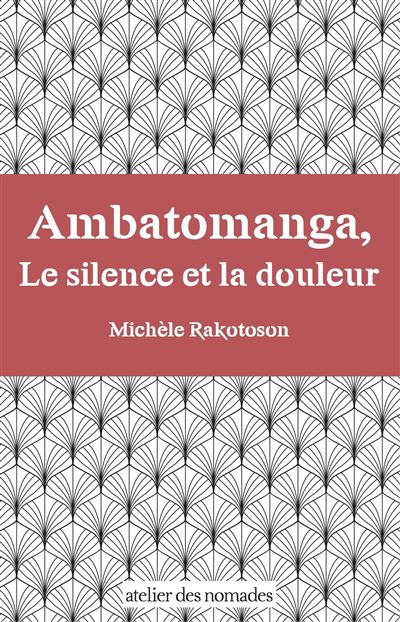 Atelier des nomades, 2022
Atelier des nomades, 2022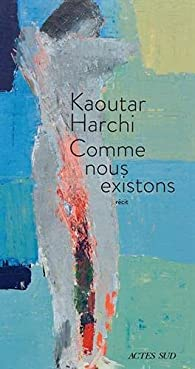 Actes Sud, Arles 2021
Actes Sud, Arles 2021

