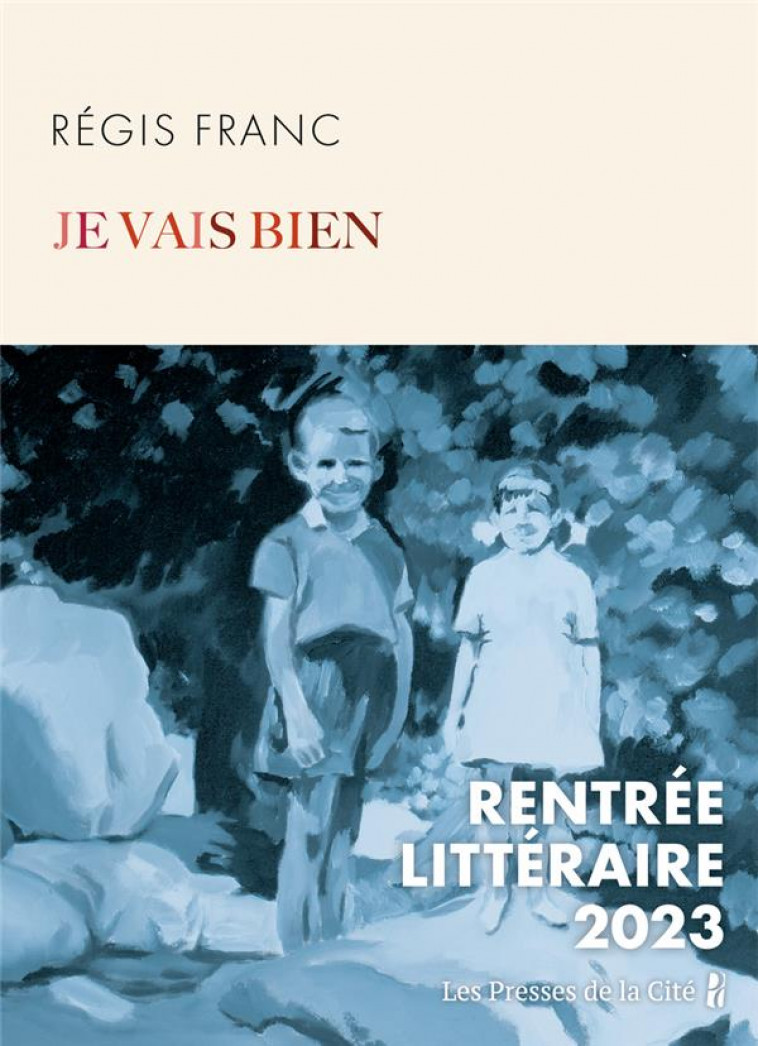Opéra disponible en dvd, mise en scène O. Py
Créé à l’Opéra de Lyon en 2013

Alors que l’on apprend le décès de l’ancien garde des sceaux, on pourra découvrir ou re-découvrir l’opéra dont il a écrit le livret, l’histoire d’après une nouvelle de Victor Hugo largement revue, de Claude, canut incarcéré à Clairvaux et guillotiné pour avoir tué le directeur de la prison.
France-musique dans l’émission Musicopolis d’Anne-Charlotte Rémond propose une présentation de l’œuvre en retraçant l’histoire de son élaboration et composition et en fait entendre plusieurs extraits.
Déjà sous la plume de Hugo, le fait divers devient un manifeste contre la peine de mort et un réquisitoire contre les injustices sociales et la défaite morale de l’incarcération. L’amitié entre Claude et un jeune détenu, Albin, blanc selon son prénom, selon vraisemblablement la morale mais non seulement la justice, offre avec l’injustice la ressort de l’intrigue. La prison est un lieu de violence, elle est aussi un lieu où la fraternité est telle qu’elle se touche, saisissante autant que saisissable.
R. Badinter a aussi défendu pendant son mandant de ministre la dépénalisation de l’homosexualité.
Les dernières livre d’Hugo, reprises au moins partiellement par l’opéra. Y a-t-il, encore aujourd’hui, à part dans un monastère, autant de Bibles, lues, que dans une prison ?
« Et maintenant dans le lot du pauvre, dans le plateau des misères, jetez
la certitude d’un avenir céleste, jetez l’aspiration au bonheur éternel, jetez
le paradis, contre-poids magnifique ! Vous rétablissez l’équilibre. La part
du pauvre est aussi riche que la part du riche.
C’est ce que savait Jésus, qui en savait plus long que Voltaire.
Donnez au peuple qui travaille et qui souffre, donnez au peuple, pour
qui ce monde-ci est mauvais, la croyance à un meilleur monde fait pour
lui.
Il sera tranquille, il sera patient. La patience est faite d’espérance.
Donc ensemencez les villages d’évangiles. Une bible par cabane. Que
chaque livre et chaque champ produisent à eux deux un travailleur moral.
La tête de l’homme du peuple, voilà la question. Cette tête est pleine
de germes utiles. Employez pour la faire mûrir et venir à bien ce qu’il y a
de plus lumineux et de mieux tempéré dans la vertu.
Tel a assassiné sur les grandes routes qui, mieux dirigé, eût été le plus
excellent serviteur de la cité.
Cette tête de l’homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la,
fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la ; vous n’aurez pas besoin
de la couper. — »
On peut trouver sur la toile plusieurs vidéos dont celle-ci.









:quality(50)/2023/09/08/amoudi-mokhtar-couv-avec-bandeau-les-conditions-ideales-64fb0813eeb3c471743287.jpg)